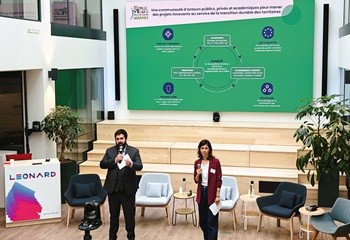Cette situation, qui n’est pas sans rappeler les défis rencontrés lors du déploiement de certaines infrastructures (transport public, fibre optique), pose la question cruciale : comment garantir une couverture équilibrée du territoire tout en sécurisant les investissements privés ? Dans ce contexte, plusieurs enjeux stratégiques et juridiques émergent.
Le modèle concessif est-il toujours la meilleure option ?
Historiquement privilégié pour l’aménagement du territoire, le modèle concessif implique que l’opérateur privé finance, installe et exploite les bornes de recharge en échange d’une exclusivité d’exploitation et, parfois, d’un soutien financier public.
Toutefois, outre le fait que le modèle concessif ne peut voir le jour que sous réserve d’une carence de l’initiative privée, le risque économique demeure encore trop élevé, notamment quand son périmètre porte sur des zones rurales : l’amortissement des investissements est plus long et les opérateurs hésitent à s’engager sans garanties suffisantes. Là encore, l’analogie avec le déploiement de la fibre optique en zones moins denses, où l’Etat a dû mettre en place un plan de financement national pour assurer un service péréqué, peut se faire, comme l’a rappelé l’Autorité de la concurrence dans son avis de mai 2024.
Comment sécuriser les parties prenantes ?
Plusieurs outils, souvent sous-exploités, peuvent aider à équilibrer les intérêts et rendre ces concessions attractives et viables économiquement, à commencer par les clauses de revoyure qui permettent d’adapter les conditions de déploiement des bornes de recharge (volume, calendrier, etc) en fonction de l’évolution du marché et du cadre réglementaire. Deuxième levier : le versement de subventions d’investissement mais également d’exploitation pour assurer l’équilibre financier du concessionnaire.
Enfin, des redevances domaniales modulables ou symboliques sur tout ou partie du projet permettent d’ajuster le coût de l’occupation de l’espace public en fonction du taux d’usage réel. Autant de mécanismes éprouvés par ailleurs dans le secteur des télécoms. Ces leviers, lorsqu’ils sont bien calibrés, permettent de mieux partager les risques et d’encourager une approche progressive et réaliste du déploiement des infrastructures.
Quelles alternatives pour avancer par étapes ?
Mais au-delà du seul modèle concessif, d’autres dispositifs méritent d’être explorés. L’Appel à Initiatives Privées constitue une alternative intéressante puisqu’il permet aux opérateurs de définir les conditions de déploiement de bornes sur fonds privés, sur un territoire donné, à la suite d’une procédure de mise en concurrence lancée par les collectivités ou syndicats d’énergie. Cette approche souple et rapide, éprouvée par des territoires de toute nature (Nancy, SIEDA, SDE Aube, Nantes, etc.), permet par ailleurs de cibler les zones délaissées par l’intervention privée justifiant une intervention publique plus poussée.
De même, des schémas hybrides, combinant concessions classiques et interventions directes des collectivités (dits « contrat mixtes »), permettraient de dépasser les contraintes du marché pour, à la fois, fournir un service aux usagers et satisfaire les propres besoins de recharge électrique des agents des collectivités.
Ainsi, l’accélération du déploiement des IRVE passe par une approche pragmatique et différenciée par territoire. En adaptant leurs stratégies contractuelles et en diversifiant les modèles économiques, les collectivités peuvent jouer un rôle de facilitateur pour garantir un accès équitable à la recharge tout en créant un cadre viable pour les opérateurs privés. Elles transformeront alors cette transition de la mobilité en une opportunité durable pour leurs territoires et leurs administrés, à l’image des grands projets d’aménagement numérique ou de transport ferroviaire.